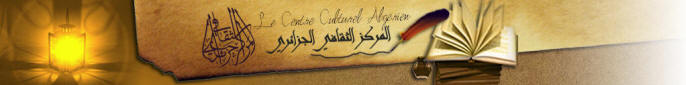Centre Culturel Algérien
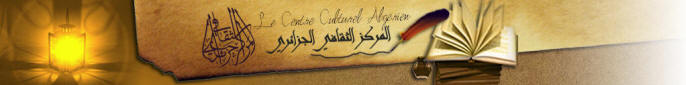
15 février 2010
débat autour du Rapt et du parcours de l'auteur
et interview non publiée*
retour à la page d'accueil
retour
à la page "Actualités diverses"
retour au sommaire de la revue de presse
* Sollicitée et réalisée plusieurs semaines
avant la rencontre-débat au CCA par la rédaction de Kalila, cette
interview n'a finalement pas été publiée par le bulletin du centre culturel
algérien. Raison avancée par la responsable de l'interview: "Plus
de place dans le bulletin à cause d'une pagination insuffisante"...
Entretien avec Anouar Benmalek: "Nous aussi, nous avons nos
Aussaresses!"
CCA (Paris)
Kalila : Un roman, Le Rapt, retraçant un fait actuel, le
rapt d’une adolescente de 14 ans, sur fond mémoriel. Pourquoi avoir interpellé
l’histoire de notre guerre de libération nationale pour narrer un tel fait ?
Anouar Benmalek : D’abord une constatation générale qui
n’est pas propre à l’Algérie : si une nation ne dispose que d’un passé mensonger
pour construire son contrat social, alors, tôt ou tard, son présent finit par le
devenir également, sans parler de son futur ! Si elles ne sont pas reconnues
comme telles, les tragédies du passé risquent de revenir, tel un boomerang,
« fracasser » le présent avec encore plus de force : en Algérie, nous avons
refusé reconnaître le caractère absolument impardonnable de Melouza, alors nous
avons eu les « enfants » naturels de Melouza : Bentalha, Raïs et Ramka !
En Algérie, que nous le voulions ou non, l’Histoire reste encore
un « présent », parce que nous n’avons pas soldé les comptes des crimes passés :
quand, par exemple, le responsable du massacre de Melouza est encore considéré
par l’Algérie officielle comme un héros national, comment voulez-vous que ne
s’ancre pas dans un certain inconscient social l’idée que la fin excuse tous les
moyens et que, donc, les terroristes, agissant au nom de Dieu, n’ont pas tort
d’agir aussi cruellement ?
Oui, la guerre de libération nationale était un acte historique
indispensable pour nous libérer de l’indignité coloniale. Oui, un nombre
incalculable de gens ont donné héroïquement leur vie pour libérer l’Algérie.
Oui, c’est à ces innombrables héros que nous devons d’avoir échappé à la
sujétion coloniale. Mais non, certains actes n’étaient pas acceptables, même
dans l’optique de la libération : le massacre de villageois, la torture
d’opposants pas moins patriotes que les plus ardents moudjahidins, les étudiants
montés au maquis égorgés sans hésitation sur de simples suspicions, tout cela
était et reste criminel, même en se plaçant dans le contexte de l’époque où une
armée aussi puissante que l’armée française n’hésitait à recourir sur une large
échelle aux représailles les plus impitoyables, allant des bombardements au
napalm jusqu’aux représailles collectives, en passant par la torture conçue
comme un instrument systématique de gestion de « l’interrogatoire », en
particulier par le biais de ses DOP, les funestes départements opérationnels
de protection.
Kalila : Faire référence à cette histoire était-il nécessaire
pour vous ?
A.B : L’Algérie est malade de ce que j’appellerai le
syndrome de l’amnésie-amnistie. Parce qu’elle a trop souffert, parce qu’elle a
peur que ces souffrances ne se répètent, l’Algérie a pris l’habitude d’oublier !
Nous croyons, en tant que nation, qu’ « oublier » une tragédie, c’est en nier
l’existence : c’est exactement ce qu’est censé rechercher l’autruche quand elle
enfonce sa tête dans le sable. Mais, évidemment, cela n’empêche pas le danger de
continuer à exister et, pis, de devenir encore plus pressant, puisqu’on ne prend
plus les précautions élémentaires pour s’en prémunir.
« Se rafraîchir » la mémoire, c’est, au contraire, un acte
salutaire. D’abord par rapport à la simple morale, ce vieux mot si méprisé de
nos jours : il doit y avoir une différence entre le meurtrier et sa victime ; le
premier ne doit pas échapper à l’opprobre, le second a droit, au moins, à
la compassion de ses concitoyens — alors que, dans le cas de Melouza, les
tueurs passent encore pour des héros, et les victimes, dont beaucoup d’enfants,
pour des traîtres méritant leur mise à mort ! Ensuite, pour nous protéger,
comme peuple et comme État, du retour de semblables malheurs : ce ne sont pas
des paroles en l’air si l’on se rappelle les boucheries sans nom de ces deux
dernières décennies.
Kalila : Comment peut-on concilier fiction et histoire sans cette
crainte d’être subjectif, de forcer le trait ?
A.B : Je ne force jamais le trait : la
vie réelle s’en charge ! Quant à la subjectivité, on n’en a jamais de
trop en littérature. Au fond, ma seule règle d’écrivain est la suivante :
faire en sorte que le lecteur ait envie de tourner une page, puis la suivante,
et ainsi de suite jusqu’à la dernière ! Je sais que je suis dans cette
« attente » de lecteur quand moi-même je « brûle » de connaître la fin de mon
livre. Je n’avais pas la moindre idée de la fin du Rapt en le commençant.
Je peux vous assurer qu’aux trois quarts du livre, j’étais encore dans les mêmes
dispositions d’ignorance quant au destin à « infliger » à chacun de mes
personnages. Pour un écrivain, cette attente perpétuelle du dénouement est
parfois éprouvante, mais lui donne la force de se mettre à sa table de travail
chaque jour que Dieu fait parce qu’il « veut » connaître la fin de son livre, un
peu comme si cette fin existait indépendamment de lui. S’il y a du suspense dans
mes livres, ce suspense existe d’abord pour moi !