
El Watan, 28 mai 2010
retour au sommaire de la revue de presse
Anouar Benmalek, auteur du livre Le Rapt (Fayard)
« La guerre de libération était indispensable, mais les crimes commis en son nom ne l’étaient pas. »
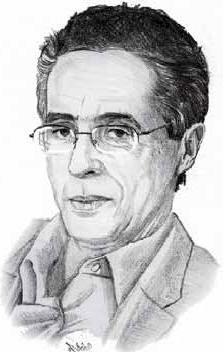
Anouar Benmalek : Nous appartenons à une sphère culturelle et religieuse qui, historiquement, magnifie le « puissant » et méprise le « faible ». Le faible n’a que le droit pour lui, tandis que le puissant est réputé jouir de tous les droits, dès lors qu’il possède les attributs de sa volonté de puissance : sa seule et suffisante légitimité réside dans sa capacité de violence à l’égard de ceux qu’il a soumis ou entend soumettre. Peu importe les moyens brutaux, immoraux ou cruels qui lui ont permis d’accéder à sa position de puissance : celui qui veut se hisser au sommet sait que, dans nos pays, si on gagne, alors on est paré de toutes les vertus. La force sans mesure, sans limitation par un quelconque contrat politique, tient lieu de règle de fonctionnement de nos communautés et, même, au fond, de morale. J’appellerais cela le syndrome Saddam Hussein, si répandu dans nos contrées…
Cette morale de la jungle où l’on n’hésite pas à se débarrasser de ses compagnons-adversaires (au besoin en les assassinant ) a été trop souvent la règle dans les rangs des dirigeants algériens (ou aspirant à l’être), que ce soit durant le conflit contre la puissance coloniale pour l’indépendance du pays ou dans la période qui a suivi le cinq juillet 1962, quand on a assisté au déchainement des appétits de pouvoir et de prédation des anciens libérateurs, civils et militaires, oublieux du jour au lendemain de la promesse faite aux martyrs de toujours s’incliner en dernier ressort devant la volonté du peuple algérien, peuple que les uns et les autres se targuaient si orgueilleusement d’avoir libéré.
Ce vieux tropisme d’admiration sidérée envers la force subvertit en profondeur notre inconscient social. Il affecte encore lourdement le regard de l’intellectuel de nos régions, même autoproclamé « démocrate », quand il lui vient à l’idée de participer aux débats (ou, plutôt, ce qui en tient lieu chez nous : les échanges d’insultes ordurières…) autour de notre histoire en général et, en particulier, d’une de ses pointes extrêmes : la guerre de libération.
L’exemple du « débat » autour d’Amirouche en est une illustration frappante. Ce qui me frappe dans ces « échanges » est le mépris absolu dans lequel sont tenues les victimes de la « bleuïte » : on oublie, de manière épouvantablement « facile », qu’il s’agit de lycéens et d’étudiants algériens pleins d’idéal, montés au maquis à l’appel du FLN et torturés et assassinés par ce même FLN. Je précise bien : FLN et non pas seulement Amirouche, car le FLN n’ayant jamais condamné les crimes de guerre d’Amirouche et de ses adjoints envers ces jeunes gens, il les a de facto cautionnés et repris à son compte ! J’ai lu et entendu bien des justifications plus ou moins embarrassées sur le comportement sanguinaire du chef de la wilaya trois, du type : c’était la guerre, on n’avait pas le temps de finasser, de discerner entre les traîtres et les innocents, toute guerre entraine des dégâts « collatéraux », la balance entre les faits d’armes d’Amirouche et ses crimes penche du côté positif, on doit pardonner l’impardonnable aux héros parce que le pays a besoin de héros, la fin veut les moyens, etc.
Je soutiens, quant à moi, que la guerre de libération était indispensable, mais que les crimes commis en son nom ne l’étaient pas. Si ceux-ci ne sont pas reconnus comme tels, alors ils imprégneront pendant longtemps la substance du présent et du futur du pays et les tueries de Bentalha et de Raïs continueront de tirer une partie de leurs monstrueuses justifications de leurs homologues des années cinquante.
Ce même mépris envers les victimes des purges sanglantes, je l’ai rencontré lors de la préparation de mon roman Le Rapt portant sur le massacre de Mellouza : j’ai eu l’impression insupportable que les malheureux habitants du village de Beni Ilemane tués sur ordre du colonel Mohammedi Saïd n’étaient que des animaux nuisibles, de l’espèce du rat ou du serpent venimeux, tant personne ne semble éprouver ou, du moins, exprimer le moindre remord ni envers eux ni envers leurs descendants. Je ne parle évidemment pas du FLN officiel, puisque celui-ci, jusqu’à présent, ne tarit pas d’éloges sur son colonel meurtrier ; je parle du reste du pays, des journalistes, des intellectuels, des hommes de religion…
Les puissants comme Amirouche et Mohammedi Saïd m’indiffèrent totalement, il s’en trouvera toujours quelqu’un pour s’affranchir à bon compte du principe du caractère sacré de la vie humaine et défendre l’indéfendable. Seul m’intéresse le destin des gens ordinaires, à quelque côté qu’ils appartiennent, pris dans les rets funestes de la grande Histoire. Mettre ces inconnus sous la lumière de la mémoire collective et leur restituer cette dignité d’être humain qui leur a souvent été refusée lors de leur mise à mort, telle a été l’ambition (insensée, probablement) qui m’a guidée pendant l’écriture du Rapt, et de manière générale, de mes autres romans. Nous ne disposons pas de portraits individuels des martyrs de la « bleuïte » et de Mellouza. Pourquoi, selon vous ? Serait-ce que nous ne saurions supporter leurs regards de reproche ?