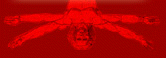|
Anouar Benmalek, L’amour-loup :
des coups de canine dans l’âme Par Catherine Siguret 15/03/02 |
|||
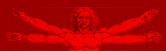 |
|||
|
|
 On
reprend le livre pour savoir à quel moment on s’est laissé envelopper, à
quel mot, à quelle phrase, notre âme a basculé pour ne devenir plus que
« le livre » du matin au soir. Mais les livres, c’est comme
l’amour, et notamment chez Benmalek, il est difficile de dater le
commencement de l’insidieux basculement du cœur à l’intérieur, dedans,
vraiment dedans, ferré tendrement et fermement, à ne plus désirer en
sortir. On
reprend le livre pour savoir à quel moment on s’est laissé envelopper, à
quel mot, à quelle phrase, notre âme a basculé pour ne devenir plus que
« le livre » du matin au soir. Mais les livres, c’est comme
l’amour, et notamment chez Benmalek, il est difficile de dater le
commencement de l’insidieux basculement du cœur à l’intérieur, dedans,
vraiment dedans, ferré tendrement et fermement, à ne plus désirer en
sortir. Le héros de L’amour-loup (Pauvert 2002) cherche à décrypter ses sentiments, parvient presque à les dater : « Je crois cependant, pour autant que quelqu’un puisse démêler un début ou une fin à un sentiment humain, je crois que c’est ce soir-là, sur ce quai sinistre de la mer Caspienne, que j’ai commencé à aimer Nawal ». Nous, on voudrait bien savoir quand, mais on aimerait surtout savoir pourquoi, on a commencé à aimer. De la même façon que le héros a chuté dans l’Autre irrésistiblement, sans savoir au juste quel lien l’a enserré si fort (la douleur ? la douceur ? l’empathie aux deux, dans une subtile alternance ?), on est tombé dans le roman et on n’a plus qu’une hâte : poursuivre. C’est finalement l’urgence : vivre l’amour, même si on sait, on sent, qu’on va s’y écorcher. Il n’y aura pas de répit. Avec Anouar, la vie, c’est la guerre ; l’amour, c’est la guerre ; et c’est le cœur à feu et à sang, mais vaillant, qu’on épouse le chemin du personnage dans un monde non moins à feu et à sang. On ne s’en plaindra jamais. Pas après pas, douane après milice, on se prend à épouser la cause et les convictions du héros, puis au fur et à mesure qu’il se découvre, lui, Chaïbane, avec sa foi d’homme. Qui est belle. On se surprend à l’accompagner dans sa quête effrénée de celle qu’il aime et qu’il sent en danger, quelque part mais il ne sait pas où, tout bêtement parce qu’on voudrait qu’il la retrouve, qu’il s’unisse à elle, qu’il ait sa petite chance d’être heureux, juste parce qu’au moins dans les livres, on espérerait naïvement que la sincérité délivre le droit au bonheur. Mais il y autre chose, où le cortex n’a aucune part. Ni les rêves d’enfant. Page, 12, ou page 15, je ne saurais dire au juste : j’y suis. Ce n’est pas que je comprends « ce que c’est que d’y être », sous les bombes, avec rivé au cœur un fantasme impossible, non : « j’y suis ». C’est beaucoup plus beau que « comprendre ». D’un coup, j’ai chaud. Je sue. J’ai peur. J’ai mal. Il y a un moment où le lecteur devient un animal, un pouls qui bat dans le héros à son insu, accomplit ses gestes, ressent ce qu’il ressent, physiquement. « Je » traverse des montagnes, des villes informes, des déserts, des steppes, une telle variété de paysages et de climats ; j’entends les tirs, les cris, les terreurs, souvent ; je traverse des places de villages poussiéreuses assommées de soleil et j’assiste à des exécutions sommaires qui ne me regardent pas et que je ne peux pas regarder parce que moi aussi, avec le héros, j’ai conscience que : « Chacun de nous possède en soi des réserves insoupçonnées de lâcheté ». Les vérités sont assénées, mais comment les fuir : je suis incapable de ne pas baisser les yeux quand la douleur de l’autre m’est crachée au visage. J’ai envie de fuir devant la violence et les chairs meurtries. Je suis habitée d’une couardise affreuse qui me ferait transcender les frontières géographiques et les idéologies politiques. Alors je ferme le livre. Je bois un lait chaud sous la couette à Paris (France), et dehors, les oiseaux sifflent quand dans Benmalek, c’étaient les balles, mais je ne peux plus dormir tout à fait comme avant. Par le biais d’une histoire d’amour magnifique qui nous mène par le bout du nez à ne pas pouvoir lâcher ce roman avant de savoir prosaïquement « comment ça finit », on prend conscience de sa petitesse et de son égocentrisme, dominés que nous sommes trop souvent par le petit mouvement intérieur de notre cœur et nos péripéties intrinsèques et volatiles. Mais on ne va pas se contenter de le déplorer en lisant, tranche par tranche, en tentant de penser à autre chose quand vraiment, la douleur du monde nous bat trop fort contre les tempes. Car il y a le « pendant » de la lecture, et « l’après ». Le roman fini – on en attaque un autre, comme Les Amants désunis (en Poche, prix Rachid Mimouni 1999) – mais surtout, autre chose commence. C’est exactement ce pourquoi on a aimé, qu’on ne cernait pas bien. On ne pouvait pas le savoir plus tôt. Car le problème avec Anouar, le voilà : ce n’est pas que de la littérature. Et l’Histoire avec un grand H, de l’Algérie comme du Liban, on n’en sort pas comme ça, juste parce qu’on a fermé le récit qui nous égratigne pas mal. Dans L’Amour-loup, c’est aussi la vraie vie qui fait le bruit du canon, pas juste les battements de cœur d’un personnage de fiction. Personne ne peut s’en tirer comme ça, y compris doté d’une conscience géopolitique proche de zéro. Dans un passage où le héros a tenté en vain de chasser un douloureux fantôme de son esprit, Benmalek écrit : « Mais cette foutue mémoire battait en lui à la façon d’un cœur obstiné. A force d’appuyer dessus, à force de tenter d’arrêter ses battements, il a senti se former sur ce cœur un œdème, celui de sa propre saloperie ». En l’occurrence, il parlait de la mémoire du sentiment, mais pour nous, une fois la lecture achevée, c’est la question de la Mémoire avec un grand M qui se pose, une œuvre majuscule décidément. Celle du monde, des hommes, de ceux qui vivent ce que nous ne vivons pas - ou plus - et que nous ne pouvons oublier sous peine de voir enfler l’œdème de notre propre saloperie jusqu’à ce qu’il nous explose de l’intérieur. La mémoire n’est pas un devoir, nous apprend Benmalek, c’est une toute bête question de vie ou de mort, et les plus épris de leur sécurité intérieure devraient les premiers veiller à s’y soumettre. Subliminale thèse d’actualité. En refermant L’amour-loup, après tant de déchirures, on se demande une fois de plus si Dieu existe- on a plus que jamais croisé des raisons d’en douter- mais on est envahi d’une sensation délicieuse : on croit un peu plus en l’homme. La capacité de l’humain à produire de la pourriture en masse ne nie pas des paramètres universels que ce roman assied avec conviction : la quête du bonheur entraîne au bout du monde, la foi en l’amour nous coule dans les veines, et les baisers perdus prennent le goût du sang. Ce sera la dernière leçon : L’amour-loup donne envie de ne plus perdre la vie qui passe à portée de lèvres et qui s’enfuit si vite. Il donne envie de vivre. Il donne envie d’aimer. » L’amour loup, Anouar Benmalek, Pauvert, 2002, 240p.  |
|
|
|
|
|
||